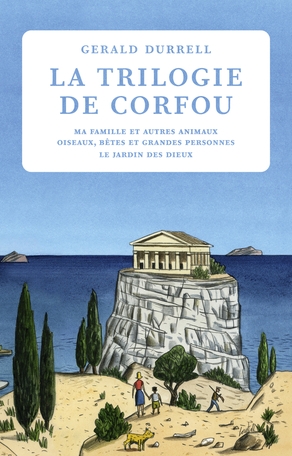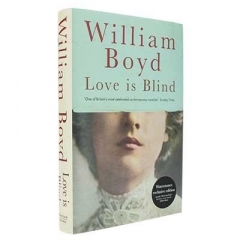Il faut absolument que tu lises ça, m’avait dit maman un jour, après avoir lu My Family and Others Animals de Gerald Durrell (1925-1995). Quand j’ai vu la nouvelle édition de La Trilogie de Corfou en un volume (La Table Ronde, 2023), j’ai su que le moment était enfin venu de découvrir Ma famille et autres animaux (traduit de l’anglais par Léo Lack). Que c’est joyeux ! Que c’est drôle !
Ce premier volet (1956) s’ouvre sur un « Plaidoyer pro domo » où l’auteur annonce son sujet : le récit d’un séjour de cinq ans avec sa famille dans l’île de Corfou : Larry, son frère aîné avait vingt-trois ans (Lawrence Durrell, l’écrivain qui écrira le fameux Quatuor d’Alexandrie) ; son frère Leslie, dix-neuf ans ; sa sœur Margo, dix-huit ans et Gerry, dix ans. De leur mère veuve à qui il dédie son livre, il écrit que « tel un Noé plein de douceur, enthousiaste et compréhensif, elle a su gouverner son navire rempli d’une étrange progéniture à travers les orages de la vie avec une grande habileté… »
C’est Larry qui déclare, pendant un mois d’août pluvieux en Angleterre, qu’ils ont besoin de soleil et d’un climat plus propice à l’écriture. Il propose Corfou, dont un ami lui a fait l’éloge. « Nous vendîmes donc la maison et, telle une bande d’oiseaux migrateurs, prîmes la fuite, loin du lugubre été anglais. » Avec leurs bagages et équipements divers, sans oublier Roger, le chien, ils accostent sur l’île « dans les vapeurs du matin » où « tout à coup, le soleil parut à l’horizon et le ciel prit la teinte bleu émail des yeux du geai. »
D’abord mal logés dans une Pension, ils se mettent à la recherche d’une villa avec salle de bains. L’aide proposée à la douane de Spiro Hakiaopoulos, qui parle anglais, va leur faciliter les choses ; ils y gagnent un ami, un chauffeur, un protecteur. Spiro déniche une maison selon leurs vœux : à mi-pente d’une colline couverte d’oliveraies, encadrée par des cyprès, « une charmante villa couleur de fraise, pareille à un fruit exotique posé dans la verdure ». Petite et carrée, la maison leur plaît. Spiro s’occupe de tout pour les y installer.
Pour Gerry, naturaliste en herbe, son « jardin de poupée était une terre magique, une forêt de fleurs » à travers laquelle, accompagné du chant des cigales, observer toutes sortes de créatures jamais vues : araignées minuscules, coccinelles de diverses couleurs, abeilles, fourmis, papillons… L’auteur raconte son émerveillement à chaque découverte et ses rencontres diverses avec des êtres humains. Comme George, un vieil ami de Larry, « venu à Corfou pour écrire », qui accepte de lui donner des cours particuliers et lui apprend « à observer et à consigner » ses observations.
Chez George, Gerry fait la connaissance du Dr Theodore Stephanides, « un amoureux excentrique de la nature », « le seul à partager [son] enthousiasme pour la zoologie ». Le garçon lui a montré en chemin un terrier de mygales, ce qui lui vaut des explications très instructives. Enchanté de leur conversation, son futur mentor lui envoie un microscope de poche et l’invite à venir prendre le thé chez lui. Tous les jeudis, Gerry se rendra dans le cabinet de travail de Theodore pour observer ses propres trouvailles.
Ma famille et autres animaux, récit à la fois autobiographique et romancé, conte aussi les petites histoires des siens, comme celle de Margo et d’un jeune Turc arrogant dont elle s’est entichée, celle de Leslie et de ses fusils de chasse, celle de Larry qui invite des amis à séjourner chez eux alors qu’il n’y a pas de place. Leur mère, d’abord furieuse, se résout à sa nouvelle suggestion : déménager dans une maison plus grande.
La villa jonquille est immense. Ils y reçoivent l’aide d’un jardinier et de sa femme hypocondriaque qui assiste leur mère passionnée de cuisine et de nouvelles recettes. Tandis que sa sœur tombe malade après avoir « vraiment » baisé les pieds de la relique de saint Spyridon à l’église, Gerry a « six hectares de jardin à explorer ». Les invités de Larry – un poète arménien, trois artistes, une comtesse –, loin d’être « ordinaires et charmants », complètent leur quatuor excentrique.
Enchanté de découvrir un jour une femelle scorpion portant « une masse de bébés minuscules », Gerry ramène comme il en a l’habitude ce spécimen à la villa dans une boîte d’allumettes, sans se douter du drame qui s’ensuivra. Sa mère décide alors de lui faire prendre des cours de français chez le consul belge, puis lui trouve un nouveau précepteur.

Gerald Durrell en Grèce à la fin des années 30 © Durrell Wildlife Conservation Trust
On verra pourquoi les Durrell vont à nouveau déménager, ce qui leur vaudra de nouvelles découvertes et d’autres rencontres hautes en couleurs, jusqu’à ce que le temps soit venu de rentrer en Angleterre pour que Gerry achève son éducation. Ma famille et autres animaux, plusieurs fois adapté pour la télévision, se termine sur ce retour, non définitif selon leur mère : « Afin d’apaiser les velléités de rébellion de la famille, elle nous dit qu’il fallait considérer ce séjour comme des vacances. Nous serions bientôt de retour à Corfou. »